Mâchez danois
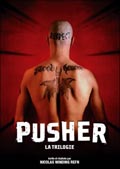
Trois films, trois uppercuts, trois tranches de vies shootées au ras du bitume, trois errances dans les banlieues glauques d’un royaume danois exsangue, trois personnages aussi attachants que pathétiques, trois destins brisés. Trois allers simples pour l’enfer. Trois films, donc…
…et un premier pour commencer.
Quand Pusher premier du nom débarque dans les salles obscures danoises en l’an de grâce 1996, Nicolas Winding Refn est un jeune réalisateur sorti de nulle part. Alors qu’il vient d’être accepté dans une grande université de cinéma, il décide de tout laisser tomber et, aidé par son entourage et un producteur, il se lance dans l’aventure Pusher à l’âge de 25 ans. Refn est un électron libre qui a su dynamiter les cases artificielles du cinéma danois érigées par l’intelligentsia critique : qui aurait pu imaginer voir débarquer de la patrie du Dogme95 ce polar pur et dur lorgnant avec bonheur du côté de l’esthétique documentaire ? Très loin des expériences arty de von Trier, Refn plonge sa caméra dans la crasse et la violence de la capitale danoise.
Le personnage principal de ce premier opus se nomme Franck. Dealer, il fréquente la petite délinquance danoise et tente tant bien que mal de s’en sortir en jonglant entre ses différents deals et les dettes qu’il doit à certains gros poissons. Un mauvais coup le fera définitivement plonger de l’autre côté de la barrière, dans une spirale infernale où le salut n’est plus qu’un lointain souvenir.
“Je te connais, Franck, tu feras que traîner avec Tonny.”
Vic
Durant la première partie du métrage, Refn dresse de façon quasi-documentaire le portrait de Franck et des personnages qui gravitent autour de lui. En particulier Vic (sa pseudo petite amie qui pratique l’effeuillage) et son pote Tonny (personnage principal du second opus). Ils évoluent laborieusement dans un Copenhague sordide, où les hôtels bon marché, les bars prolos et les ruelles glauques semblent le seul horizon dépressif existant. Impression décuplée par l’utilisation d’une lumière naturaliste qui ne cache aucun des stigmates du décor urbain et des protagonistes. Franck et son embonpoint alcoolique, Tonny et sa gueule cabossée, Vic et sa maigreur maladive. Ils passent leurs journées à glander et à dealer, s’envoyant sans cesse des rails de coke pour mieux oublier l’apathie qui les guettent à chaque instant. Ils sont filmés dans les bars, durant les nombreux trajets qu’ils effectuent en voiture, lors d’un deal. On suit pas à pas le quotidien de ces deux petites frappes.
Exercice risqué. Ce genre de chronique peut rapidement tomber dans un voyeurisme misérabiliste et inintéressant, laissant de côté le spectateur pour cause de surplace narratif rédhibitoire. Mais avec Pusher, hors de question pour le spectateur de décrocher. Dès le début on est happé par cette chronique qui finira en folie ordinaire.
Tout d’abord l’utilisation magistrale de la caméra à l’épaule permet à Refn de nous engager impitoyablement dans la narration. Elle ne cesse de suivre Franck, comme greffée, elle implique le spectateur dans un rapport quasi corporel avec ce qui se passe à l’écran. Ici, il ne s’agit pas d’un artefact artificiel, mais d’un véritable projet esthétique qui permet à Refn d’échafauder un discours sur la violence et la délinquance à mille lieux de toute glorification, mais aussi de se départir de toute considération moralisante.
Nous sommes (il est) trop près, trop proche de ces personnages pour nous (se) permettre tout jugement. Il enregistre la pulsation d’une délinquance à bout de souffle. Une pulsation qui n’aura de cesse de partir en vrille crescendo, tandis que Franck, de par ses actions toujours plus incompréhensibles, creusera sa propre tombe. Au départ, selon la loi de la rue, il n’a pas grand-chose à se reprocher. Il doit bien de l’argent à Milo (protagoniste du troisième opus), mais sa conduite reste impeccable, il n’a pas balancé aux flics et veut vraiment rembourser ses dettes. Pourtant face au mur d’emmerdes qui se dresse devant lui, il va peu à peu perdre tout raisonnement sensé et se jeter la tête la première dans une course à l’issue inéluctable.

Refn a eu l’intelligence de faire de son personnage un être humain ordinaire, loin, très loin du gangster bigger than life que l’industrie cinématographique nous ressert ad nauseaum. Un homme donc, pas forcément sympathique mais loin d’être détestable, plein de contradictions et de faiblesses, comme le montre sa relation contrariée avec Vic. Pute de luxe qu’il aime mais à qui il ne veut pas montrer le moindre signe d’affection physique autre que la laisser le sucer de temps à autre. Faiblesse aussi, lors de ce qui est sans doute la plus belle scène du film, où, désespéré, il en vient à demander de l’aide à sa mère pour rembourser sa dette. C’est la seule personne à qui il expliquera la situation inextricable dans laquelle il se trouve. On le voit alors débarrassé de tout ses oripeaux de gangster, juste un petit garçon, les yeux mouillés, suppliant à demi-mot celle qui l’a enfanté de le sortir de toute cette merde. Elle lui donnera alors tout ce qu’elle a en liquide dans un bouleversant geste d’amour. Don, bien sûr insuffisant, qu’il acceptera dans un sanglot. Au moment de partir, alors que sa mère veut le prendre dans ses bras, il refusera le contact, par fierté, par honte…
Ici on touche à l’essence même du cinéma de Refn : saisir ce qui reste d’humanité dans un quotidien à la noirceur insondable.
Dans ce monde interlope, l’amitié n’est qu’une chimère auquel personne ne croit mais que tous font semblant de cultiver. Durant la première partie du métrage, Franck et Tonny nous sont présentés comme deux potes inséparables, faisant tout ensemble, à tel point que l’on peut y déceler un sous texte homo ironique assez prononcé. Mais cette soi-disante amitié indéfectible est balayée d’un revers de main quand Franck apprend qu’il aurait été balancé aux flics par Tonny. Enragé, Franck va retrouver son ancien pote pour le passer à tabac dans un bar. L’altercation est ultra violente, il décharge toute sa haine sur un Tonny totalement incapable de riposter. Il va même jusqu’à se saisir d’une batte pour terminer le travail. Tonny, ce "meilleur pote" - ils bouffent, draguent et dealent ensemble, ils sont tout le temps l’un avec l’autre et une véritable fraternité semble exister - devient par la faute d’une possible absence de courage un simple punching-ball que Franck détruit consciencieusement, sans remord.
Les relations que Franck a tissées avec Milo et Radovan sont du même acabit. Quand il va le voir, tout n'est que grand sourire, franche camaraderie, tape dans les dos et blague grivoise. Milo lui fait goûter la bouffe infâme qu’il cuisine à longueur de journée, lui demande d’aider Radovan a amené un frigo pour sa fille, et est prêt à faire un effort pour qu’il est le temps de rassembler l’argent qu’il lui doit. Une sorte de respect mutuel et d’appréciation réciproque semble exister dans cette relation triangulaire. Mais bizness is bizness et quand les choses s’enveniment, Milo et Radovan n’ont plus de limite, Franck devient un mauvais payeur et ces gens là ils doivent cracher ou mourir. Radovan qui se confiait à Franck sur ses perspectives futures quelques jours auparavant se met à le torturer à l’électricité comme s'il lui était inconnu, prenant même un certain plaisir à balancer le jus sur un Franck impuissant. Au final, pour nos deux compères il n’est rien, un dealer de plus. Rien d’autre. Comme dans la haute société où les bonnes manières cachent des luttes de pouvoir d’une rare violence, l’amitié chez les gangsters ne vaut rien, elle n’est qu’un écrin fantoche masquant la réalité. Ce qui compte c’est la violence et le pouvoir qu’elle permet d’asseoir.
“Si jamais tu te pointes pas demain avec 50 000 je te casse en deux.”
Milo

Chez Refn la violence est systémique. C'est-à-dire qu’elle innerve en profondeur les relations humaines et sociales. Franck qui rejette avec brutalité les gestes d’affections de Vic, la relation ambivalente qui se terminera en explosion vengeresse entre Franck et Tonny, Milo et Radovan qui n’hésite jamais à faire couler le sang des mauvais payeurs : Pusher est parcouru sans cesse d’une violence latente qui cherche la moindre fêlure pour envahir le cadre et embraser l’action. La réception de cette violence est d’autant plus dure à encaisser pour le spectateur que la caméra à l’épaule n’oppose aucun filtre permettant une certaine déréalisation ou esthétisation de la barbarie. Il n’y a jamais chez Refn cette tentation d’enjoliver la réalité, de valoriser des actes cruels par l’intermédiaire d’une esthétique artificielle apte à injecter une plus value. A l’inverse de tout un pan du cinéma actuel qui cherche à rendre attrayant et superficiel la violence du monde et des hommes qui y vivent, ici les affrontements sont laids, sans héroïsme ou prouesses physiques. Le déferlement de la brutalité qui anime les protagonistes de Pusher n’est jamais attendu ou espéré par le spectateur, au contraire elle surprend et met mal à l’aise. Refn ne sombre jamais dans la spectacularisation ou le voyeurisme morbide qui sont clairement les deux défauts qui lui pendait au nez, la mise en scène de la violence reste sèche et sans effets toute en gardant une puissance d’évocation rare. Il restitue avec précision ce qui fait l’essence du comportement de ses personnages : leur animalité.
Une scène est emblématique de ce surgissement de l’ultra violence, il s’agit du moment où Franck, pressé par un Milo impatient de retrouver son fric, part avec l’homme de main de ce dernier, Radovan, pour récupérer de l’argent que lui doit un junkie et ainsi commencer à rembourser sa dette. Ils le retrouvent dans un squat crasseux, le junkie est apeuré et l’attitude violente de Franck ne fait que renforcer son sentiment d’insécurité. Epaulé par Radovan il va tenter de lui faire cracher l’argent qu’il lui doit, mais ce petit jeu va se retourner contre lui puisque le junkie au bout du rouleau va se suicider devant ses yeux, d’une chevrotine en pleine tête, le sang retapissant d’une grosse éclaboussure gore les personnages et le lieu.
Ici le trajet menant à la déflagration est clairement identifié. La scène fonctionne comme un crescendo dans lequel la violence passe par plusieurs stades avant de finir en apothéose sanglante. On varie de la violence verbale de Franck cherchant à intimider, rabaisser, manipuler le junkie, à la violence physique de Radovan brisant les dernières défenses psychologiques du camé. Au fond du trou, sans échappatoire, il ne peut qu’en finir.
Après le suicide, l’absence de réaction de Franck et Radovan montre bien à quel point cette violence extrême et la mort qui en découle est totalement intériorisée dans leurs manières de fonctionner. Le junkie n’est rien d’autres qu’un mauvais payeur et le fait qu’il soit mort n’a rien de catastrophique pour eux, c’est un cadavre de plus sur une longue liste. Le respect de la vie, les relations humaines (le frère au junkie est un pote à Franck), ne semblent avoir aucune prise sur ces hommes, il s’agit avant tout d’asseoir son pouvoir, de montrer qui a les plus grosses et par là même être craint et respecté pour sa stature de gangster sans pitié.
Quand la mise en scène de Refn doit se frotter à la violence et à la manière de la montrer, il garde le cap de son projet esthétique, à savoir montrer le quotidien d’un gangster sans œillères, ni a priori. La violence explose à la face du spectateur, mais jamais elle ne se transforme en spectacle sanguinolent duquel un certain plaisir pourrait naître. Il ne s’agit pas ici de se dresser en père la morale façon Haneke (un bon petit revenge movie bien foutu vaudra toujours mieux qu’un pensum intello façon Funny Games) mais plutôt de remarquer l’implication et le sérieux jusqu’au-boutiste d’un réalisateur qui croit dur comme fer à son propos. Les scènes dans lesquelles la violence explose sont toutes filmées selon un schéma reconnaissable, à savoir une première partie avec mouvements de caméra rapides, abrupts, comme pour épouser le climat tendu qui habite la scène. Le montage de son côté se fait nerveux, heurté, mais Refn a l’intelligence et le talent de ne pas transformer ces moments en bouillie épileptique ; au contraire, l’action reste toujours visible et l’impact sur le spectateur décuplé puisqu’il arrive à allier à la fois la brutalité de l’action et un filmage faisant corps avec la violence. On retrouve cette manière d’appréhender l'agressivité dans trois scènes emblématiques que nous avons déjà évoquées : le junkie, le passage à tabac de Tonny par son pote Franck et la torture électrique par Radovan. A chaque fois nous avons une première partie montrant une violence sans filtre, dans toute sa crudité. Puis Refn, lors du deuxième mouvement, change sa caméra d’épaule et opte pour une nouvelle façon de montrer ces excès, sollicitant plus la capacité d’imagination du spectateur pour induire une distanciation avec les actes commis propice à une réflexion sur ce qui est montré à l'écran. Au sommet de la violence la caméra de Refn se fait plus discrète, derrière un bar elle ne peut filmer entièrement Franck en train de défoncer à coups de batte Tonny, un mouvement de caméra rapide empêche aux spectateurs de voir la tête du junkie exploser, le courant qui saute plonge dans le noir le corps de Franck alors qu’il est martyrisé à l’électricité par Radovan. Cette rétraction du regard comme s'il était impossible de montrer le stade final de la violence est clairement pensé par Refn, comme le montre la répétition sous des angles différents du même mode opératoire de mise en scène. Elle lui permet d’éviter un certain voyeurisme qu’il récuse de toutes ses forces, et d’injecter une distanciation salutaire dans un tel malstrom de sensations.
“ C’est vrai ce que les gens disent. T’es complètement cintré. ”
Lars

Franck a tout perdu. Milo veut sa peau, il n’a pas réussi à trouver le fric qu’il lui doit et ses exactions suicidaires l’ont mis sur la liste noire de nombreux délinquants de la capitale danoise. Il est au bord du gouffre, le regard vitreux, la démarche raide, les bouffées de colère toujours plus violentes. C’est un mort en sursis et rien ne semble le faire dévier de sa trajectoire. Sa seule planche de salut pourrait être de tout abandonner et de fuir avec Vic et le peu d’argent qu'il lui reste. Une possibilité acceptée un instant à la grande joie de cette dernière, se mettant à espérer une autre vie. Mais cette espérance durera seulement quelques instants puisque suite à un coup de téléphone de Milo, Franck revient sur sa décision dans l’espoir tout à fait illusoire de régler ses problèmes. Vic ne le supportera pas, et le trahira en lui volant son argent, le laissant seul sur un parking désolé de la périphérie, et prenant conscience pour la première fois du destin qui l’attend.
Cette volte-face de Franck, en apparence incompréhensible (à aucun moment le spectateur ne peut croire que Milo va s’adoucir et pardonner), représente en fait le dénouement logique du fil narratif déroulé par Refn depuis le début du métrage. Au commencement il y a Franck et une caméra qui lui colle aux basques : dès ces premiers instants où l’on entre en contact avec ce personnage, le poids de la ville pèse sur ses épaules comme une chape de plomb, il est prisonnier de ce magma bitumeux et rien ne pourra l’en sortir. Le reste du film n’est qu’une longue et douloureuse descente aux enfers, où l’on voit un Franck sociologiquement programmé pour la délinquance faire ce que l’on attend de lui et même un peu plus. Son “Qu’est-ce que j’irais foutre en Espagne !?” sonne alors comme une épitaphe, le point final apposé par Franck lui-même sur son destin. Toute sa vie il s’est battu pour se faire une place dans le microcosme délinquant. Il a réussi en partie à devenir “quelqu’un”, un dealer de seconde zone possédant un minimum de pouvoir, comme le montre l’une des toutes premières scènes quand il arnaque avec Tonny un revendeur. Lorsque tout cela disparaît en une petite semaine, il se retrouve nu, prisonnier d’un mirage mortifère qu’il a contribué par chacun de ses actes à bâtir, tel son propre tombeau.
Avec ce premier opus, Nicolas Winding Refn tape un grand coup. Poème urbain sans concession, Pusher se pose comme un grand film sur la déliquescence du petit gangstérisme. En prenant comme objet principal un voyou de bas étage, et en ne le lâchant sous aucun prétexte (l’acteur incarnant Franck est de toutes les scènes du film à l’exception d’une), Refn parvient à nous plonger comme rarement auparavant dans le quotidien crasseux d’un loser pathétique. Sa mise en scène lorgnant du côté de Friedkin et du Scorsese des débuts lui permet d’imprimer une apprêté et une véracité exemplaire, d’autant plus que les acteurs, tous exceptionnels, impriment une profondeur rare au film.
A travers Pusher s’opère une démythification radicale du statut de gangster dans la fiction cinématographique. Une mise a plat que Refn va poursuivre et approfondir avec les deux autres volets de cette trilogie tout bonnement indispensable.
PUSHER
Réalisateur : Nicolas Winding Refn
Scénario : Nicolas Winding Refn & Jens Dahl
Production : Henrik Danstrup, Teddy Gerberg…
Photo : Morten Soborg
Montage : Anne Osterud
Bande originale : Povl Kristian & Peter Peter
Origine : Danemark
Sortie française : 28 juin 2006 (1996 au Danemark)

